Danse féminine en Afrique : l’évaluation d’une universitaire
- Par Yannick ZANGA
- 06 août 2025 13:45
- 0 Likes

Le mouvement est comme une obsession dans les travaux interdisciplinaires du Pr. Mirelle Flore Chamba Nana épouse Aretouyap. L’enseignante-chercheuse, maître de conférences à l’Institut des Beaux-Arts de l’Université de Dschang à Foumban est une spécialiste en histoire et esthétique de la danse. On retrouve sa démarche d’exploration postcoloniale du corps et du genre. Dans l’ouvrage « Danser au féminin en Afrique : état des lieux, défis et perspectives », coécrit avec le Pr. Robert Fotsing, professeur titulaire de littérature comparée à l’Université de Dschang, et paru aux éditions Présence africaine au premier trimestre 2025. Le Pr. Chamba Nana épouse Aretouyap dévoile quelques bribes de son diagnostic sur la danse féminine en Afrique.
Quel est l'élément déclencheur de l'intérêt pour la danse féminine en contexte africain ?
Historiquement, les danses traditionnelles souvent réservées aux femmes, servaient à célébrer des rites, mariage, initiation, cultes ancestraux et à transmettre des valeurs communautaires. La colonisation a tenté de réprimer ces pratiques, mais elles ont persisté comme forme de résistance, renforçant leur importance identitaire. Après les indépendances, la danse est devenue un outil de revendication et d'émancipation notamment à travers des styles comme le bikutsi, où le corps féminin exprime à la fois tradition et modernité. Aujourd’hui, la modernisation et les réseaux sociaux ont amplifié cet intérêt : des danses comme les danses urbaines et contemporaines sont devenues des phénomènes globaux, mêlant autonomisation et esthétique africaine. C'est le cas chez Agathe Djokam, Chantal Gondang, Audrey Fotso etc. Ainsi, l’attrait pour la danse féminine africaine repose sur son triple héritage : sacré, politique et artistique tout en incarnant une dynamique actuelle de créativité et fierté culturelle.
Quels est en quelques mots l'état des lieux sur le continent ?
La danse au féminin en Afrique se professionnalise progressivement malgré les tabous et obstacles divers. Avec l'organisation des danseuses en compagnie par exemple, le directeur de compagnie ou d’école de danse joue un rôle clé dans la valorisation des danses féminines. Actrice à la fois culturel, économique et social, les femmes structurent ce secteur longtemps informel en professionnalisant les formations. C'est l'exemple de Germaine Acogny à l’École des Sables au Sénégal et Chantal Gondang avec la maison de la culture à Douala. Elise Mballa Meka a joué un rôle important dans ce sens au Cameroun en négociant des partenariats internationaux qui jusqu'aujourd'hui ont permis l'émergence des femmes dans la danse au pays. Le plus grand défi est de concilier l'authenticité et la modernit...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)









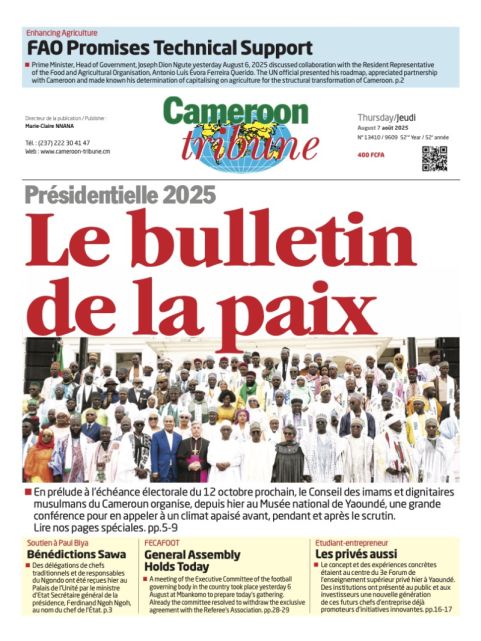
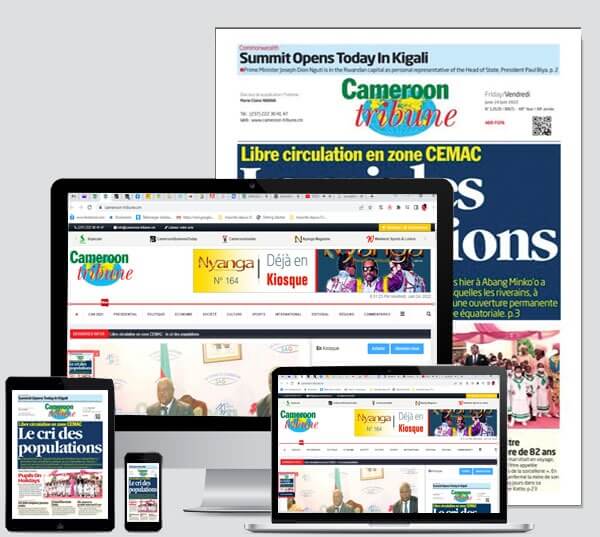


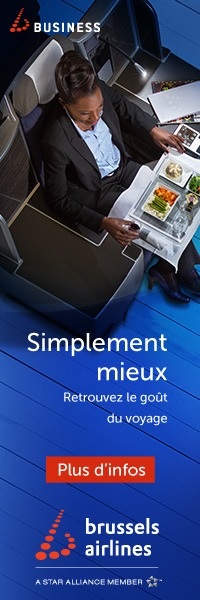
Commentaires