« Ces avancées n’ont pas abouti à des avancées concrètes »
- Par Sainclair MEZING
- 21 août 2025 13:46
- 0 Likes

Dr. Serge Christian Alima Zoa, internationaliste, Centre de recherche et d’études politiques et stratégiques (CREPS) de l’Université de Yaoundé II-Soa, Université catholique d’Afrique centrale.
Le président Donald Trump a reçu tour à tour les présidents russe Vladimir Poutine, ukrainien, Volodymyr Zelensky, et plusieurs dirigeants européens. Quelle lecture faites-vous de cette série de rencontres et quel impact sur le conflit russo-ukrainien ?
Les récentes rencontres du président Donald Trump avec Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, bien que symboliquement significatives, n'ont pas abouti à des avancées concrètes vers une résolution du conflit russo-ukrainien. Déjà lors du sommet bilatéral Trump- Poutine à Anchorage en Alaska le 15 août dernier, présenté comme une étape cruciale vers la paix dans la guerre en Ukraine, aucun accord tangible n'a été conclu. Sans cessez-le-feu et avec une invitation à Moscou, la réunion de près de trois heures entre les deux dirigeants a soulevé plus de questions que de réponses. Poutine a profité de cette rencontre pour renforcer sa position sur la scène internationale, sans faire de concessions majeures. Trump, de son côté, a exprimé des positions alignées sur certaines demandes russes, notamment en s'opposant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et en envisageant des concessions territoriales. Le président Volodymyr Zelensky, accompagné de plusieurs dirigeants européens, est retourné lundi dernier à la Maison blanche dans le cadre de nouvelles discussions, sans aboutir à un cessez-le-feu. Bien que les discussions aient permis de clarifier certaines positions, elles n'ont pas été couronnées d’avancées capitales, ni décisives vers la paix. Les quelques points clés à retenir de ces discussions, comme la perspective d’une rencontre entre Poutine et Zelensky, les atermoiements entre un cessez-le-feu et les accords de paix, les garanties en matière de sécurité, viennent conforter aux yeux de plusieurs observateurs, qu’un éventuel processus de négociations n’en est en réalité qu’à ses débuts.
Pensez-vous que le sommet en vue entre Poutine et Zelensky pourrait aboutir à la paix ?
L’annonce d’une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky est un signal diplomatique important, mais ne suffit pas, puisque les combats sur le terrain militaire continuent et même intensément, à conclure qu’on s’achemine vers la paix. Il est plutôt perçu par certains observateurs comme un signe de désescalade relative, car la tenue d’un dialogue direct entre deux parties en guerre marque une rupture avec la logique de confrontation totale. Cela peut indiquer une ouverture tactique de la Russie, affaiblie économiquement et militairement, ou un réalisme stratégique de l’Ukraine, face à l’essoufflement de l’aide occidentale. En théorie des conflits, un canal bilatéral actif est une condition nécessaire à la négociation, mais pas suffisante à la paix. Les différences fondamentales de position persistent avec, d’une part, Moscou cherchant à consolider des gains territoriaux et imposer des garanties de neutralité à l’Ukraine, et d’autre part, Kiev soutenu par le droit international, exigeant le retrait total des forces russes et le rétablissement de l’intégrité territoriale. Ces positions antagonistes, sans compromis clair, limitent la probabilité d’un accord global rapide. L’environnement géopolitique incertain n’est pas à négliger. Les États-Unis sous Trump paraissent prêts à pousser vers un accord, quitte à sacrifier des exigences ukrainiennes. L’Europe, divisée, souhaite un cessez-le-feu mais refuse des concessions imposées sans son aval. L’absence de garanties internationales solides ou de médiateur crédible nuit à la crédibilité du processus. Au demeurant, comme opportunité, si les deux dirigeants acceptent un compromis minimal entre autres, cessez-le-feu, corridors humanitaires, gel temporaire des combats, cela peut poser les bases d’un processus plus long. Comme risque, si la rencontre échoue, cela pourrait radicaliser les positions, renforcer la lassitude internationale et relancer les hostilités.
Fait marquant : Donald Trump n'a pas reçu ses hôtes avec les mêmes égards. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence d’estimes ?
La différence d’égards accordés par Donald Trump à Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et aux dirigeants européens peut s’expliquer par une combinaison de facteurs géopolitiques, stratégiques, idéologiques et psychologiques. D’abord, le réalignement stratégique des États-Unis. Trump prône une politique étrangère centrée sur l’unilatéralisme et les intérêts américains directs, souvent au détriment du multilatéralisme traditionnel. Avec Poutine, le président américain adopte une posture de coopération pragmatique, perçue comme un moyen de contenir la Chine et de redessiner l’ordre mondial sans passer par l’Europe ou l’OTAN. Avec Zelensky, Trump considère l’Ukraine comme un élément de négociation, pas comme un allié stratégique de premier plan. D’...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)










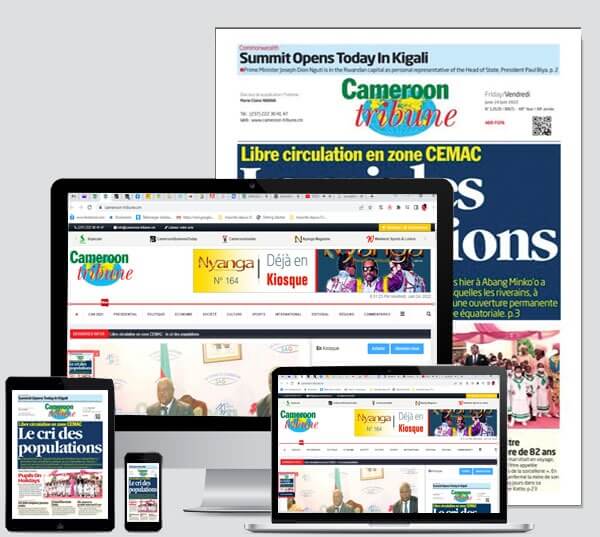


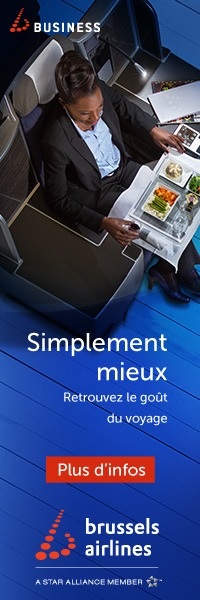
Commentaires